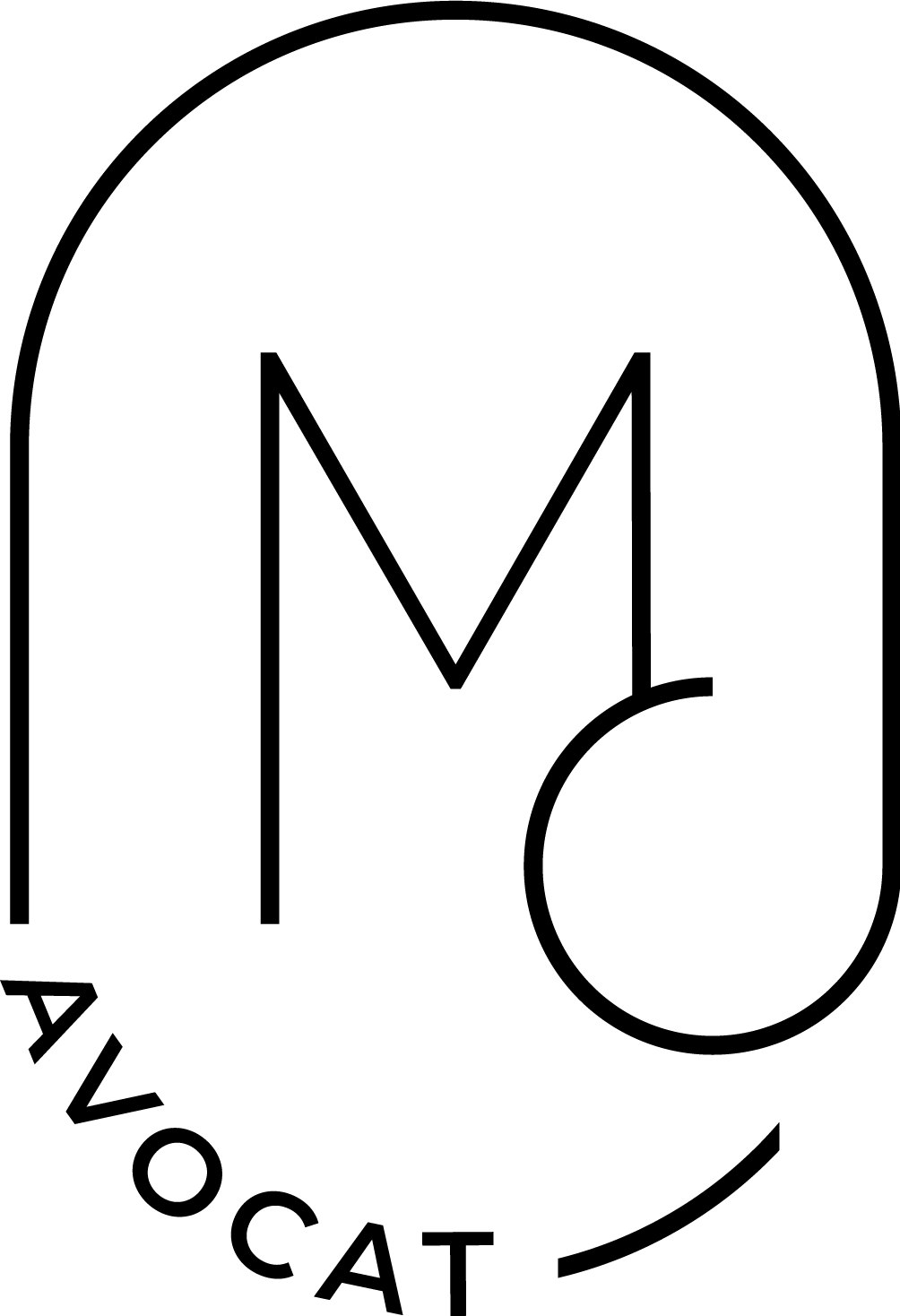Le droit de se taire a fait l’objet de nombreuses applications ces derniers temps. Ce droit trouve son fondement dans l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789[1]. S’il a d’abord été cantonné à la procédure pénale – et notamment à la garde à vue – il connaît, depuis plusieurs années, une extension significative vers les procédures administratives et disciplinaires dotées d’un caractère répressif.
L’année 2025 illustre particulièrement ce mouvement, avec plusieurs décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État venues préciser les contours de cette garantie, notamment dans le champ des sanctions prononcées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), ou encore, certaines instances ordinales.
La CNIL : consécration du droit de se taire en procédure de sanction
Par sa décision du 8 août 20251, le Conseil constitutionnel a jugé que la personne mise en cause devant la formation restreinte de la CNIL devait être informée de son droit de se taire. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans sa décision rappelle « Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ».
En conséquence, les garanties attachées aux droits de la défense, et en particulier le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, doivent s’appliquer.
L’AMF : une application différée du droit de se taire
Le Conseil constitutionnel a également récemment appliqué la problématique du droit de se taire s’agissant des procédures menées par l’AMF. Dans une décision du 21 mars 20252, il a été jugé que les enquêteurs de l’AMF n’avaient pas à notifier le droit de se taire lors des visites domiciliaires et auditions conduites sur place.
Le Conseil constitutionnel avait ainsi relevé que ni le texte contesté ni la jurisprudence de la Cour de cassation n’associent la mise en œuvre du droit de visite à l’existence préalable de soupçons pesant sur la personne dont les déclarations peuvent être sollicitées lors de cette opération[2]. Un tel constat avait d’ores et déjà été soutenu en matière de « référé pénal environnemental »[3].
Au cas présent, le Conseil constitutionnel indique que « les dispositions contestées [l’article L621-12 du Code monétaire et financier autorisant les visites domiciliaires et permettant aux enquêteurs de solliciter des explications des personnes sollicitées sur place] n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause ».
La distinction opérée reposerait donc sur la chronologie procédurale : tant que la notification des griefs n’est pas intervenue, la personne sollicitée n’est pas encore « mise en cause » et ne bénéficie donc pas de la protection. Le droit de se taire ne trouve à s’appliquer qu’à compter de l’engagement effectif de la procédure de sanction et non au seul stade de l’enquête.
Poursuites disciplinaires : application du droit au silence
Le Conseil d’État a également consolidé le champ d’application du droit de se taire dans le cadre des procédures disciplinaires devant les ordres professionnels.
Dans une décision du 19 décembre 2024, il a été jugé qu’un vétérinaire poursuivi disciplinairement devait être expressément informé de ce droit[4]. La même solution a été retenue le 25 février 2025 pour un médecin poursuivi devant l’ordre des médecins[5].
Ces décisions prolongent des précédentes jurisprudences ayant d’ores et déjà étendu l’exigence de notification du droit de se taire à diverses procédures disciplinaires visant magistrats, fonctionnaires ou membres des chambres régionales des comptes. Elles consacrent l’unité du régime juridique applicable à toutes les instances susceptibles de prononcer une sanction à caractère punitif.
Une garantie à vocation transversale
Ces évolutions confirment que le critère déclencheur de l’application du droit de se taire réside dans la mise en cause effective d’une personne dans une procédure répressive, qu’elle soit pénale, disciplinaire ou administrative.
La décision du Conseil constitutionnel du 8 août 2025 concernant la CNIL illustre la consolidation de ce droit dans le champ de la régulation numérique.
L’ensemble de ces décisions témoigne de l’ancrage du droit de se taire comme principe transversal, destiné à assurer la protection des droits de la défense dans tout contentieux de nature punitive.
Le cabinet se tient à votre disposition afin de vous accompagner et de vous représenter en cas de poursuites disciplinaires ou dans le cadre d’un contrôle ou d’une procédure de sanction menée, notamment, par la CNIL.
[1] Sur la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser », voir la décision Conseil constitutionnel, 2 mars 2004, n°2004-492 DC
[2] Voir le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/20251128qpc/20251128qpc_ccc.pdf
[3] Conseil constitutionnel, QPC du 15 novembre 2024, n° 2024-1111.
[4] Conseil d’État, 19 décembre 2024, n° 490952.
[5] Conseil d’État, 25 février 2025, n° 491214.
Photographie Sebastian Pichler sur Unsplash