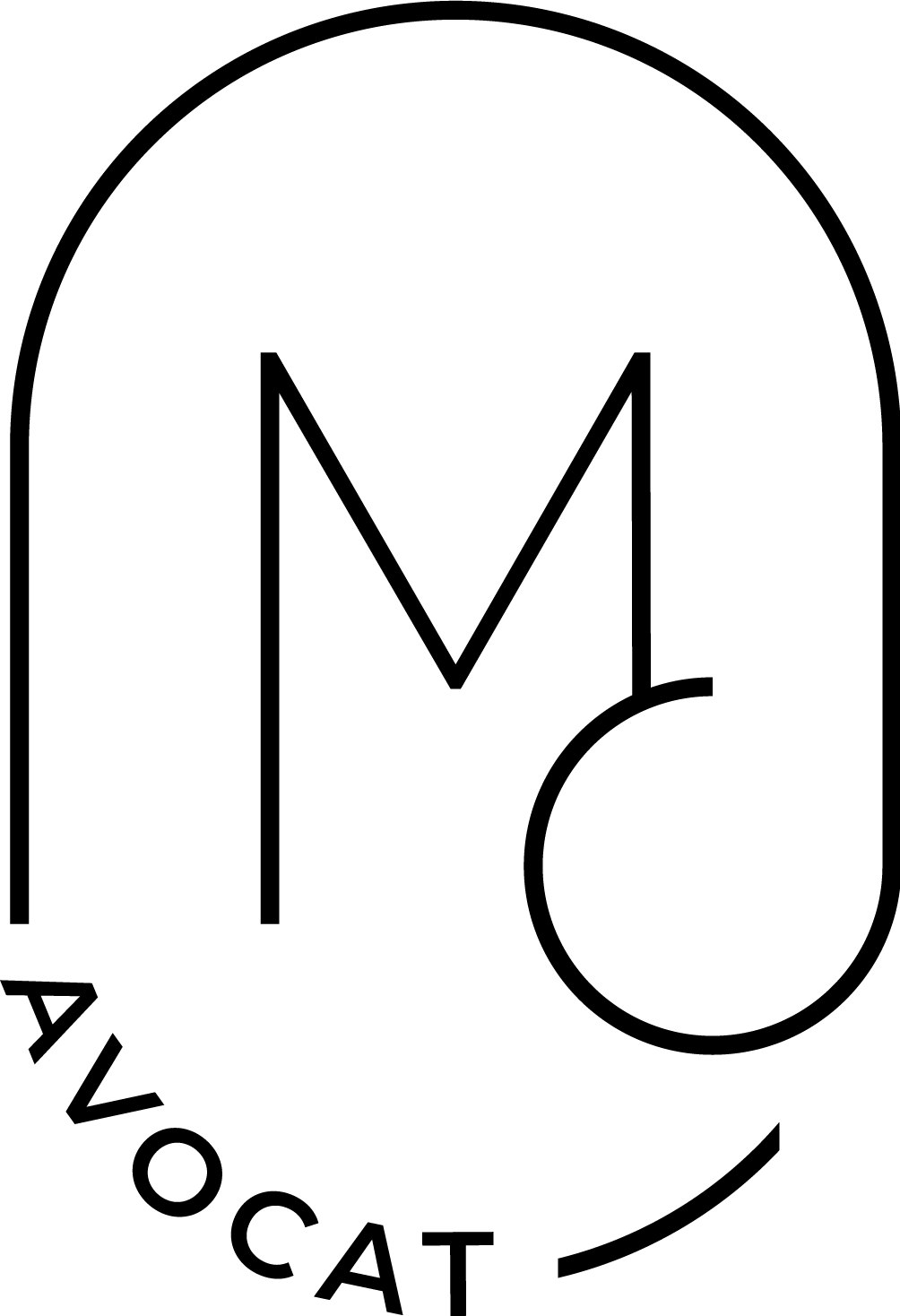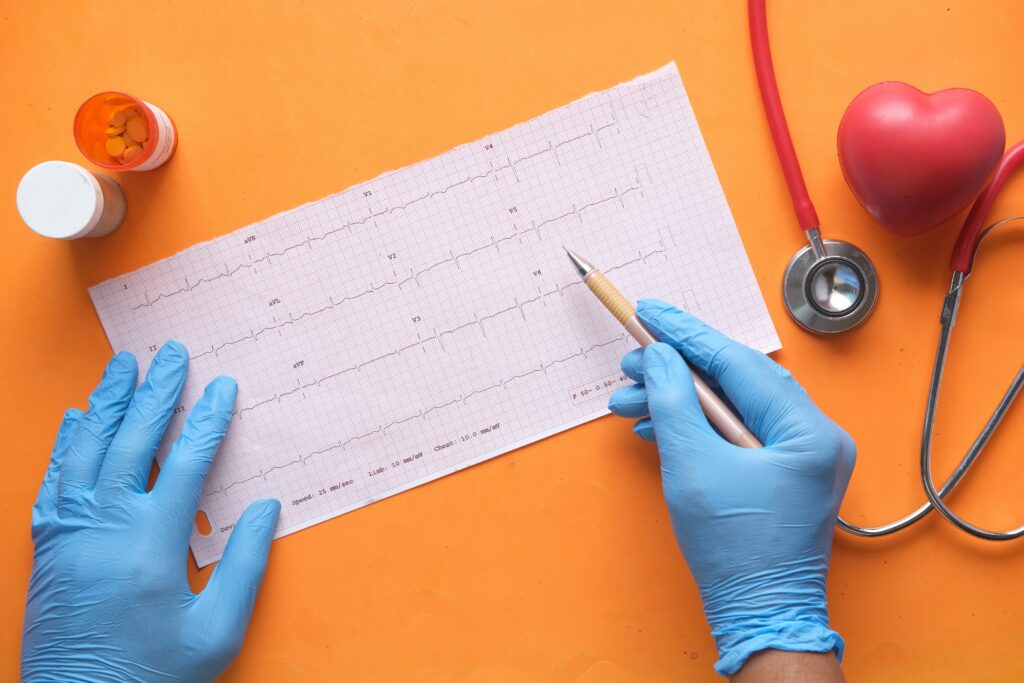À la croisée du droit de la santé et du droit du numérique, l’accès aux informations médicales constitue aujourd’hui une garantie essentielle pour les patients. Inscrit dans le Code de la santé publique, il s’articule également avec le droit des données personnelles tel que consacré par le Règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD »).
Ce droit illustre le principe de transparence en matière de santé, en permettant au patient de mieux comprendre et de mieux maîtriser son parcours de soins. En cas de décès, les proches du patient peuvent également – dans certaines circonstances – accéder aux informations médicales du patient.
Le droit d’accès de la personne à ses informations médicales
L’article L.1111-7 du Code de la santé publique pose le principe selon lequel « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé », dès lors que ces informations sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels.
Cette règle s’applique aussi bien en médecine de ville qu’en milieu hospitalier, et concerne une large variété de documents : résultats d’examens, comptes rendus de consultation ou d’hospitalisation, prescriptions, feuilles de surveillance, correspondances médicales[1]. En revanche, le code de déontologie médicale rappelle que les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers[2].
Il est par ailleurs à noter que les établissements de santé, et plus globalement, les professionnels de santé par capillarité, sont soumis à des obligations de conservation du dossier médical pendant une durée de 20 ans à compter de la date du dernier séjour du patient dans l’établissement ou de la dernière consultation (des durées de conservation spécifique étant envisagées en cas de décès du patient ou de minorité de celui-ci)[3].
En parallèle, l’article 15 du RGPD consacre le droit d’accès de toute personne à ses données à caractère personnel, ce qui inclut les données de santé, lesquelles font l’objet d’un traitement dédié au sein du RGPD[4]. En effet, l’article précité consacre le droit, pour une personne concernée, d’obtenir la confirmation que ses données sont traitées et d’avoir accès à de nombreuses informations parmi lesquelles les catégories de données à caractère personnel concernées, les finalités du traitement, les destinataires, etc ; et d’obtenir une copie desdites données.
Les deux régimes s’articulent donc : le droit de la santé consacre l’accès au dossier médical, tandis que le RGPD en renforce la portée en imposant aux responsables de traitement (professionnels de santé, établissements) une obligation de transparence accrue.
Sur le plan pratique, la demande d’accès peut être adressée directement au professionnel ou à l’établissement de santé concerné. Le patient n’a pas à justifier sa demande, qui peut donner lieu à la consultation sur place ou à la délivrance de copies. Les délais sont encadrés : la communication doit intervenir dans les 8 jours suivant la demande, ou dans les 2 mois si les informations datent de plus de 5 ans.
Dans le cadre du RGPD, le délai de réponse est fixé à un mois, pouvant être prorogé de 2 mois compte tenu de la complexité et de la nature des demandes.
L’obtention d’une première copie du dossier médical doit être gratuite pour le patient, conformément à une récente jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne[5].
En cas de non-respect du droit d’accès du patient à ses données, divers recours s’offrent à lui et peuvent varier en fonction de la nature et du type d’établissement détenant son dossier (recours devant la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, référé, etc.).
L’accès aux informations médicales relatives à une personne décédée
L’accès au dossier médical d’une personne décédée se heurte au principe du secret professionnel, consacré à l’article L.1110-4 du Code de la santé publique. Ce secret couvre l’ensemble des informations médicales, même après le décès, et interdit en principe leur communication aux tiers.
Toutefois, ce même article aménage des exceptions strictement encadrées. Les ayants droit du défunt, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) peuvent obtenir communication des informations médicales dans trois hypothèses précises :
1. Connaître les causes de la mort ;
2. Défendre la mémoire du défunt ;
3. Faire valoir leurs droits.
Ces motifs doivent être clairement invoqués par la personne qui sollicite l’accès. En effet, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs a justement pu rappeler s’agissant du motif lié à la défense de la mémoire du défunt et le fait de faire valoir leurs droits que le demandeur devait préciser les circonstances pour permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant[6].
Les personnes précitées ne pourront néanmoins pas accéder aux informations dès lors que le défunt aurait exprimé une volonté contraire avant son décès. Dans la pratique, il appartient aux établissements et professionnels de santé de vérifier le statut de l’ayant droit et le bien-fondé du motif invoqué.
Là encore, les modalités de communication sont encadrées : consultation sur place ou remise de copies, dans les délais prévus par l’article L.1111-7 du Code de la santé publique. Le Conseil d’État a précisé que l’absence de de communication aux ayants droit des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès, comme le retard à les communiquer dans un délai raisonnable, constituent des fautes susceptibles d’entrainer un préjudice moral[7].
Cette articulation entre le respect du secret médical et la reconnaissance d’un droit d’accès des proches reflète l’équilibre instauré entre la protection de l’intimité du patient et l’intérêt légitime des ayants droit.
Le droit d’accès aux informations médicales est un pilier du droit du patient. Si les principes sont clairs, leur mise en œuvre pratique soulève souvent des difficultés, tant pour les patients et leurs proches que pour les professionnels et établissements de santé qui doivent répondre aux demandes.
Le cabinet se tient à la disposition des personnes qui souhaitent obtenir communication de leur dossier médical ou se heurtent à un refus de communication de leurs informations ainsi que des structures de santé qui souhaitent mettre en œuvre des procédures de gestion des demandes d’accès au dossier médical.
[1] Le contenu du dossier médical est précisé par l’article R.1112-7 du Code de la santé publique.
[2] Article R.4127-45 du Code de la santé publique.
[3] Voir l’article R.1112-7 du Code de la santé publique précité s’agissant des durées de conservation.
[4] Article 9 du RGPD.
[5] CJUE, 26 octobre 2023, C-307/22.
[6] CADA , avis, 31 déc. 2019, nos 20192033 et 20192055.
[7] CE 13 févr. 2024, no 460187.